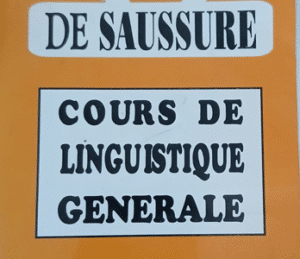Regards critiques sur le Cours de linguistique générale (CLG) de Saussure et ainsi que sur quelques-uns de ses concepts fondateurs
Dr Abderrahmane AYAD
Maitre de conférences, HDR, en sciences du langage
IMPORTANT pour les étudiants en langue arabe, en langue étrangères, en traduction et SUROUT ceux qui se spécialisent en sciences du langage
Remarque : Les astérisques (*) suivant certains concepts signifient que ces derniers sont définis dans le dictionnaire.
La linguistique, en tant que discipline reconnue par l’épistémologie, ne s’est imposée qu’après qu’avec l’enseignement de Saussure, et tout justement suite à la genèse postérieure de son Cours de linguistique générale en 1916.
Jusqu’au 20ème s., on s’intéressa à l’évolution* des langues dans le temps* et aux liens de parenté les unissant. Critiquant les défauts de la linguistique historique, F. de Saussure bâtit son Cours de linguistique générale, publié en 1916 par ses deux disciples Charles Bally et Albert Sechehay et à partir duquel s’élabora toute la linguistique moderne. C’est une œuvre posthume, réunie des notes de ses disciples. Saussure a posé les concepts fondamentaux : synchronie*, système*, distinction entre langue* et parole*, etc. HACHETTE dictionnaire encyclopédique illustré 2000, entrée « linguistique » : 1095-1096).
Cependant, il importe de faire remarquer que cet ouvrage a fait l’objet de plusieurs critiques. Voire, la linguistique saussurienne a reçu de manière générale beaucoup de reproches. Ont ainsi été relevées quelques contradictions, précisément dans le CLG.
Pami ces dernières :
-Le fait, tel qu’il nous est apparu, d’avoir défini la langue comme « un produit social » et avoir a contrario attribué à la linguistique le seul objet d’« étude de la langue en elle-même et pour elle-même » ; autrement, en faisant table rase de toute la dimension sociale et sociologique de la langue, ce qui pose en fait un sérieux problème méthodologique dans l’analyse des faits linguistiques et extralinguistiques.
-Des lacunes telle que la négligence de la dimension énonciative de la langue, et de s’être intéressé à la parole tout en omettant le locuteur, pourtant producteur de la parole !
-La séparation même qu’il a faite du langage et de la langue, et ayant conçu celle-ci comme un fait social extérieur à l’homme, etc.
-La staticité de la linguistique par le fait d’avoir exclu le volet historique de la langue et s’être majoritairement préoccupé de la synchronie.
-Des « dérapages » dont nous avons eu l’occasion de constater, notamment le rejet de la question de l’origine du langage et des langues, son adoption du principe darwinien de l’évolution et que l’homme était comme un simple animal privé de langage et de parole criant dans la nature…
-Cette dernière conception saussurienne sous-entend que les premiers hommes vivaient hors société.
-Elle suggère également que l’être humain était privé de langage, donc de pensée !
-Cette allégation saussurienne, la science expérimentale demeure à ce jour incapable de la démontrer, ce qui va, et cela va de soi, à l’encontre de la démarche scientifique empirique, qui celle-ci même étant cependant fortement revendiquée par Saussure, que seuls les faits prouvés et vérifiés intéressent sa linguistique.
Par-là, depuis déjà les toutes premières années de la parution du CLG, plusieurs linguistes ont exprimé leur suspicion à son sujet. Certains sont même allés à remettre en cause le fait que beaucoup d’idées qui y sont énoncées soient réellement celles de Saussure ; d’autres se sont attelés à le décortiquer et rendre compte de ses défectuosités.
Font partie de ces éminents linguistes et penseurs contemporains de Saussure : Antoine Meillet (1866-1936), Mikhaïl Bakhtine (1895-1975), Motoki Tokiéda (1900-1967), Émile Benveniste (1902-1976), Roland Barthes (1915-1980), Robert Lafont (1923-2009), Michel Foucault (1926-1984), William Labov (1927-2024), etc.
Pour une lecture poussée et plus récente sur les critiques formulées contre le CLG, voir : Simon Bouquet, « Il faut relire Ferdinand de Saussure dans le texte », [Entretien avec Laurent Wolf]. In Le nouveau quotidien, Genève, 1997 ; Simon Bouquet, « Introduction à la lecture de Saussure », 2004 ; MEJÍA QUIJANO C. “Rudolf Engler. L’ouvrage d’un philosophe artiste”. In Cahiers Ferdinand de Saussure (58) : 5-19, 2006 ; MEJÍA QUIJANO C. « Sous le signe du doute. Présentation des textes de E. Constantin ». In Cahiers Ferdinand de Saussure (58) : 43-67, 2006 ; Sofia Estanislao, « Qui est l’auteur du Cours de linguistique générale ? » Recherches sémiotiques / Semiotic Inquiry, 34 (1-2-3), 39–57, 2014.
Et c’est de ce dernier article que nous avons tiré les références ci-dessus ; et il en contient d’autres encore. Notons de plus que l’auteur (Sofia Estanislao) a consacré d’autres écrits à ce sujet, dont figurent : « Petite histoire de la notion saussurienne de ‘’valeur’’ ». In Parallèles floues. Espaces théoriques du langage. Cl. Normand & E. Sofia. Louvain-la-Neuve : Academia, 2013 ; « Cent ans de philologie Saussurienne. Lettres échan-gées par Ch. Bally & A. Sechehaye en vue de l’édition du Cours de linguistique générale ». In Cahiers Ferdinand de Saussure (66) : 181-197, 2013 ; La collation Sechehaye du ‘cours linguistique générale’ de Ferdinand de Saussure (1913). Édition, introduction et notes par E. Sofia. Leuven : Peeters, 2015 ; Le CLG à travers le prisme de ses (premières) réceptions. Cahiers Ferdin-and de Saussure, Vol. 69 ; pp. 29-36, 2016 ; « Quelle est la date exacte de publication du CLG ? », Cahiers Ferdinand de Saussure, pp. 9-16.
Outre cela, mis à part les critiques que l’ouvrage a reçues, d’autres linguistes ont aussi critiqué quelques-uns des concepts saussuriens, et ont remis en question la conception que Saussure en a eu et fustigé sa méthode d’analyse. Parmi ces concepts figurent les notions de langue*, d’arbitraire* du signe*, de valeur*, les dichotomie* langue*/parole*, synchronie*/diachronie*…
Ainsi, un des premiers linguistes ayant constaté et rapporté les contradictions de Saussure, est le linguiste Japonais Motoki Tokiéda.
Je rapporte ici un échantillon de ses critiques cité par Eisuke Komatsu (« La critique de la théorie saussurienne d’après Motoki Tokiéda (1941) » (Linx Revue des linguistes de l’université Paris X Nanterre 7 | 1995 : 258-262). Voici la traduction (de Catherine Garnier) l’extrait.
Saussure a voulu, pour des raisons méthodologiques, ne pas prendre comme objet le langage concret qui est notre expérience. Il a voulu isoler à l’intérieur du langage concret, hétérogène et multiforme, quelque chose qui soit homogène et uniforme. Il a fait de cette entité l’objet de sa recherche, l’a appelée « langue », l’a reconnue comme étant un objet psychique, association d’une image acoustique et d’un concept, et l’a définie comme ayant une existence séparée, étant un fait social extérieur à l’individu. La langue prise comme objet est censée posséder une organisa-tion structurée. Elle n’a de lien avec le sujet parlant que quand il l’utilise. Mais Saussure ne définit pas clairement le lien entre le sujet et cet objet ainsi utilisé. La plus grande contradiction de Saussure c’est que, si la langue est l’objet de la linguistique l’observation concrète ne peut se faire que sur la parole. Toute la théorie de Saussure n’est alors que le résultat d’une sorte d’objectiva-tion du langage pour répondre à des préoccu-pations méthodologiques. »
Dr Abderrahmane AYAD, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Sciences et pratique, Béjaia, 2025, pp. 269-273.